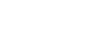Dans le cadre du programme régional ACSE (Air, Climat, Sol, Énergies), les Chambres d’agriculture du Grand Est travaillent à l’élaboration d’un guide pratique pour accompagner les agriculteurs et les collectivités dans le développement de projets agrivoltaïques.
L’agrivoltaïsme, à la croisée des enjeux énergétiques et agricoles, suscite un intérêt croissant. Toutefois, la réglementation reste en évolution, et les retours d’expérience sur le terrain demeurent limités. Il est donc essentiel d’avancer avec prudence, en s’assurant que ces projets respectent l’équilibre entre production agricole et production énergétique.
Une approche structurée pour ne rien oublier
Le guide imaginé par les Chambres d’agriculture du Grand Est vise à apporter des repères concrets pour évaluer la pertinence de tels projets, en tenant compte des réalités agricoles et territoriales. Il se veut être un outil pratique, structuré autour de cinq grands axes :
- Cadre réglementaire et contexte énergétique : pour comprendre les obligations, les opportunités et les limites actuelles.
- Étapes de développement d’un projet : de l’idée initiale jusqu’à la mise en service et au suivi.
- Différents types de portage et valorisation de l’électricité : qui pilote le projet et comment l’électricité produite est utilisée ?
- Montage juridique : structuration des projets, baux et modes de contractualisation.
- Fiches par types d’activités agricoles : technologies photovoltaïques adaptées, enjeux spécifiques et points de vigilance pour chaque coactivité.
Au-delà des aspects techniques et juridiques, le guide met l’accent sur la nécessité d’une approche prudente. L’absence de recul sur certains modèles agrivoltaïques impose une analyse fine des enjeux et des éventuels impacts sur la production agricole.
Un outil pour les agriculteurs et les collectivités
En apportant des repères concrets et des clés de décision, ce guide ambitionne d’accompagner les porteurs de projets dans la construction de solutions viables. Il ne s’agit pas seulement de présenter les opportunités de l’agrivoltaïsme mais surtout d’apporter une compréhension globale des enjeux et des étapes à ne pas négliger.
De la définition du projet à sa mise en œuvre, le document vise à outiller les agriculteurs et les collectivités pour qu’ils puissent aborder ces projets avec discernement. Il couvre les dimensions juridique, agricole, technologique et économique, en veillant à ce qu’aucun aspect ne soit laissé de côté lors de la conception. Cette approche permet d’anticiper les contraintes, de sécuriser les engagements et de garantir que les installations photovoltaïques restent au service de l’activité agricole et non l’inverse.
Publication imminente
Le guide sur l’agrivoltaïsme, actuellement en phase de finalisation, devrait être publié dans les mois à venir. Il s’inscrit dans le cadre de la dernière année du troisième programme régional ACSE, qui aborde pour la première fois cette thématique émergente.
Au-delà de la conception des projets, un suivi rigoureux des installations agrivoltaïques s’avère indispensable. Ce suivi permettra de collecter des données scientifiques fiables, spécifiques aux conditions pédoclimatiques et aux pratiques agricoles de la région Grand Est. En documentant l’impact réel sur les cultures, les sols, l’élevage et la rentabilité des exploitations, ces données constitueront un socle essentiel pour éclairer les futures décisions, tant pour les agriculteurs que pour les collectivités. En ce sens les Chambres d’agriculture du Grand Est espèrent que l’agrivoltaïsme pourra s’inscrire comme un axe prioritaire de la future programmation ACSE.
À travers cette dynamique, l’objectif reste inchangé : offrir aux acteurs du monde rural les outils nécessaires pour aborder l’agrivoltaïsme avec discernement, en sécurisant chaque étape du développement de projet et en garantissant que la production agricole demeure la priorité.
|
Agrivoltaïsme : une opportunité pour la transition énergétique L’agrivoltaïsme, pour les agriculteurs et plus particulièrement les éleveurs, représente une opportunité de diversification tout en préservant leur mission première : nourrir la population. Toutefois, pour éviter des dérives et maximiser les bénéfices, des règles et des bonnes pratiques encadrent son développement. Soumise à consultation publique en 2024, la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) fixe les grandes orientations de la politique énergétique de la France pour les années à venir. Elle met l’accent sur la sobriété énergétique, le développement de la méthanisation et l’électrification du mix énergétique. Dans ce contexte, l’agrivoltaïsme émerge comme une solution clé pour concilier transition énergétique et durabilité agricole. À La Bouzule, en Meurthe-et- Moselle, la ferme de l’Ensaia constitue un exemple emblématique. Elle associe une unité de méthanisation à des panneaux photovoltaïques bifaciaux, capables de produire de l’électricité plus longtemps. Pour Yves Le Roux, professeur à l’Ensaia, cette installation illustre parfaitement les synergies possibles entre production d’énergie renouvelable et activité agricole. Le modèle de La Bouzule montre comment un site agricole, et notamment un élevage, peut devenir producteur d’énergie tout en renforçant son autonomie et en s’adaptant aux enjeux climatiques. Un compromis à encadrerL’État encourage en priorité l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures, notamment dans une logique d’autoconsommation. Cependant, le photovoltaïque au sol coûte deux fois moins cher, ce qui relance le débat. « Face à cette réalité économique, l’État veut aussi soutenir cette technologie », affirme Yves Le Roux. L’agrivoltaïsme apparaît alors comme un compromis, à condition de respecter des règles strictes pour préserver la vocation agricole des terres. Depuis l’arrêté du 5 mars 2024, les projets agrivoltaïques doivent impérativement rendre un service à la parcelle. Cela peut se traduire par une protection contre la grêle, une amélioration du bien-être animal ou encore une adaptation au changement climatique. Les éleveurs et les prairies sont donc particulièrement ciblés. L’ombre créée par les panneaux permet notamment de réguler la température au sol, un avantage pour les animaux en période de forte chaleur. Des critères techniques encadrent les installations : la perte de rendement agricole ne doit pas dépasser 10 %, l’excédent brut d’exploitation (EBE) doit être maintenu, le taux de couverture de la surface limitée à 40 %, la puissance plafonnée à 5 MWc par projet et une zone témoin est exigée pour mesurer les impacts. L’objectif est clair : garantir une productivité agricole minimale tout en limitant les effets négatifs comme la diminution de certaines cultures, la réduction de la biodiversité ou les nuisances sonores. Les références solides manquentDes plateformes expérimentales, comme celle prévue en 2025 en Haute-Vienne, permettront de tester différentes technologies agrivoltaïques et d’évaluer leur impact sur l’environnement. Car si le potentiel est important, l’agrivoltaïsme manque encore de références solides. Selon Yves Le Roux, son développement doit s’appuyer sur plusieurs recommandations : assurer une cohérence entre le projet agricole et la production d’énergie, garantir un partage équitable de la valeur ajoutée, encourager le regroupement des agriculteurs et harmoniser les exigences envers les développeurs. Autre piste évoquée : repenser le cadre contractuel, en proposant des alternatives au bail rural afin d’éviter les déséquilibres dans les relations entre exploitants et développeurs. Car les enjeux sont considérables. Pour les agriculteurs, et notamment les éleveurs, l’agrivoltaïsme représente un levier stratégique pour diversifier leurs revenus, renforcer leur autonomie et contribuer activement à la transition énergétique. Encore faut-il que cette démarche repose sur un équilibre durable entre production agricole, environnement et énergie. |