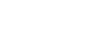Si des dispositifs ont été mis en place pour prévenir et soulager la détresse psychologique des agriculteurs, ils ne sont pas suffisants. Seules de nouvelles politiques publiques permettront d’éviter en tout cas de réduire le phénomène qui frappe de nombreux agriculteurs.
« Il y a 20 % de plus de risque de suicide chez les agriculteurs que dans la population entière. Ils sont 20 % à avoir des pensées sinistres contre 10 % dans l’ensemble de la population », notait Sébastien Denys, Directeur Santé Environnement Travail chez Santé publique France, lors d’un récent colloque organisé par le député Arnaud Simion, (PS, Haute-Garonne) à l’Assemblée nationale. Comme les policiers et les professions de santé, les agriculteurs sont particulièrement frappés par des dérèglements de la santé mentale qui peuvent aboutir au suicide. Les agriculteurs sont aussi ceux qui ont le plus recours aux psychotropes, parmi toutes les professions a-t-il précisé. Au premier rang de ce mal-être, l’isolement et la solitude, mais aussi les difficultés financières. Généralement, le suicide a une origine multifactorielle quand on y ajoute les accidents de la vie, les problèmes de santé, la pénibilité et l’épuisement au travail, les addictions à l’alcool ou la drogue, les vols sur les exploitations, les prédations sur les troupeaux…. Sans parler du dérèglement climatique avec son cortège de sécheresses, d’inondations, d’épizooties qui compromettent les récoltes et la santé des animaux. Les agriculteurs évoquent également la surcharge administrative, la multiplication des normes et contrôles, l’agribashing et le climat de suspicion dont ils sont victimes, notamment lors des contrôles, voire le traitement de l’agriculture par les médias.
Au nom de la terre
« C’est le film ‘‘Au nom de la terre’’ d’Edouard Bergeon en 2019, qui a brisé un tabou », observent Olivier Damaisin, ancien député et Coordinateur national interministériel du plan de prévention mal-être en agriculture, ainsi que le sénateur Henri Cabanel (PS, Hérault). Jusqu’à une période assez récente, le sujet était ignoré par les organisations professionnelles agricoles et les responsables politiques et surtout peu médiatisé. Depuis les politiques se sont saisis du sujet et rédigé de nombreux rapport, comme celui d’OIivier Damaisin sur « l’identification et l’accompagnement des agriculteurs en difficultés et la prévention du suicide en agriculture » en 2020, puis celui d’Henri Cabanel « Suicides en agriculture : mieux prévenir, identifier, accompagner les situations de détresse », en 2021. En 2023, Daniel Lenoir, ancien directeur de la MSA est l’auteur d’un nouveau rapport de l’Inspection générale des affaires sociales sur la « Prévention du mal-être et du risque suicidaire en agriculture ». Peu à peu, des actions ont été mises en place par Santé publique France sur la sensibilisation des médecins et des professions de santé, des services d’urgence des hôpitaux pour faire remonter les signalements, la création d’une cohorte avec la MSA pour suivre l’état de santé des travailleurs agricoles sur une longue période et la création de bases de données pour identifier plus précisément les causes de décès dans la population agricole.
MSA et Chambres d’agriculture mobilisées
Dès 2011, la Mutualité sociale agricole (MSA) lançait un premier plan de prévention. Elle est à l’origine du réseau « Sentinelle » qui mobilise 8 000 à 10 000 personnes pour détecter sur le terrain les agriculteurs et salariés agricoles en situation de détresse psychologique. Plus récemment, elle a créé le dispositif Agri-écoute, un numéro d’appel, avec un psychologue au bout du fil, que les personnes en difficulté peuvent solliciter. C’est la MSA qui a également mis en place une aide au répit qui vise au remplacement temporaire des exploitants dépressifs et à leur accompagnement administratif. « Quand par exemple le courrier s’entasse et n’est plus ouvert », explique Magalie Rascle, directrice déléguée aux politiques sociales à la Caisse centrale de MSA. Les Chambres d’agriculture sont également mobilisées dans le cadres de cellules « Réagir ». Les agriculteurs en difficulté peuvent solliciter ces cellules pour bénéficier d’un accompagnement technique, pour intervenir auprès de la MSA, des services des impôts et des banques et obtenir des allègements et/ou reports de leurs charges. « Plus on intervient tôt et plus nous sommes en mesure de redresser la barre », résume Sébastien Albouy, encore président de la Chambre d’agriculture de Haute-Garonne.
Changement de politique agricole
Mais la plupart des intervenants ont convenu que si ces dispositifs sont nécessaires et « répondent à une urgence », selon Marie-André Besson, présidente de Solidarité Paysans, ils ne sont pas suffisants. Seul un changement de politique agricole prenant en compte la situation de détresse des agriculteurs peut contribuer à corriger le tir de façon pérenne. Et de citer un meilleur accompagnement des agriculteurs contraints de faire évoluer leurs pratiques agricoles pour satisfaire aux nouvelles exigences environnementales, la nécessaire simplification administrative, « un sujet compliqué », selon Henri Cabanel, la redistribution des aides…. Malheureusement déplore Marie-André Bresson, comme d’ailleurs le député Dominique Potier, agriculteur (PS, Meurthe-et-Moselle), « la loi d’orientation agricole qui vient d’être votée » n’aborde pas le sujet.
|
Mal-être : 7 200 signalement en dix-huit mois Selon les dernières données du réseau des programmes Prévention du mal-être agricole (PMEA) géré par des caisses de la MSA, ce ne sont pas moins de 7 200 signalements qui ont été détectés au cours des 18 derniers mois. De son côté, le système Agri Écoute a enregistré 2 318 appels qualifiés en 2023, puis 1 889 durant le premier semestre 2024, soit une augmentation de 57 %. En moyenne, chaque caisse de la MSA traite 120 signalements par an. Les alertes concernent principalement les hommes (63 %), le plus souvent célibataires (54 %) et principalement des non-salariés de 67 % (contre 28 % pour des salariés agricoles). La nature des difficultés rencontrées reste multifactorielle : santé physique ou psychologique (29 %), surcharges administratives, juridiques et économiques (25 %), problèmes liés à la vie professionnelle ou à la vie privée (17 %). |