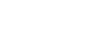Un groupe d’agricultrices du Grand Est, membres de la Commission régionale des agricultrices de la FRSEA, a parcouru le Rwanda pendant près de dix jours dans le cadre d’un voyage d’étude organisé par l’AFDI Lorraine. Ce séjour leur a permis de rencontrer des agricultrices et agriculteurs rwandais, de découvrir les pratiques agricoles locales et d’échanger sur leurs expériences respectives. Retour sur une immersion riche en enseignements.
L e Rwanda, surnommé le “pays des mille collines“, est un petit pays d’Afrique de l’Est couvrant une superficie d’environ 26.338 km² (soit l’équivalent de la surface de la Lorraine) dont la capitale est Kigali. Avec une population d’environ 13 millions d’habitants, il se distingue par une forte densité de population (500 hab/ km²), et une économie largement basée sur l’agriculture. Grâce à un climat tempéré et des terres fertiles, le pays a su développer une production agricole variée.

Rwanda : le pays des mille collines. © Photo DR
L’agriculture, un pilier de l’économie
L’agriculture représente environ 25 % du P1B du Rwanda, et occupe plus de 70 % de la population active. Elle constitue la principale source de revenus pour de nombreuses familles rurales, et joue un rôle fondamental dans la sécurité alimentaire du pays. La superficie moyenne des exploitations s’élève à 50 ares, très morcelés, rendant difficiles les pratiques agricoles modernes ainsi que la sécurité alimentaire des familles. Le Rwanda se distingue par une production agricole diversifiée comme les pommes de terre, le maïs, le riz, le sorgho, les haricots, le manioc, les oignons… et de nombreux fruits (bananes, ananas, mangues, avocats…) constituant essentiellement des cultures vivrières. Le thé, le café et les pyrèthres sont les principales cultures industrielles, contribuant au développement économique du pays. Le gouvernement rwandais met en œuvre des politiques visant à moderniser et à structurer le secteur agricole, avec une attention particulière portée à la formation des agriculteurs, à la création de coopératives et à l’amélioration de l’accès aux marchés. Toutefois, la mécanisation reste limitée, et la majorité des travaux agricoles repose encore sur la maind’œuvre manuelle.
Une immersion dans une histoire tragique
Dès leur arrivée, les agricultrices du Grand Est ont visité le mémorial du génocide de Kigali. Ce fut un moment chargé d’émotion qui leur a permis de mieux comprendre l’histoire récente du pays, et la force de résilience de son peuple. Le génocide des Hutu contre les Tutsi en 1994 constitue l’un des événements les plus dramatique de l’histoire moderne du Rwanda. En seulement cent jours, plus d’un million de morts, 300.000 orphelins et des milliers de veuves. Le mémorial rend hommage aux victimes, et sert de lieu de recueillement, mais aussi d’apprentissage pour éviter que de telles atrocités ne se reproduisent.
Rencontres et découvertes agricoles
Lors de leur séjour, les agricultrices françaises ont eu l’opportunité de rencontrer des membres de l’Association nationale IMBARAGA (lire encadré), partenaire d’Afdi Lorraine, et de visiter diverses exploitations rwandaises, témoignant de la diversité et de la richesse agricole du pays. À maintes reprises, elles ont pu échanger avec des groupes locaux d’agriculteurs. Ils bénéficient d’un encadrement de l’association sur les actions mises en place sur leur ferme. À titre d’exemples, le projet GEA/Afdi-Gestion des Exploitations Agricoles leur permet de les impliquer dans la gestion par un enregistrement des dépenses et des recettes. Beaucoup de coopératives ont recours aux tontines. Il s’agit d’un système d’épargne ou de crédit par une collecte d’argent affectée à divers projets économiques (comme l’achat d’animaux) ou sociaux (pour résoudre des difficultés personnelles). Les agriculteurs peuvent suivre des formations pour améliorer leurs productions, combattre la malnutrition en développant des cultures nutritives, tout en les incitant à la protection de l’environnement par compostage ou apport d’engrais organique.
Les agricultrices du Grand Est ont pu ainsi découvrir :
* Le thé
À Rusizi, sur plus de 1.000 hectares, elles ont ainsi découvert toutes les étapes de la production de thé : pépinière, cueillette à la main, visite de l’usine de transformation en thé noir et commercialisation. Elles ont pu échanger avec les différents acteurs de la filière qui met en avant la qualité de la marchandise (certifiée ISO 22.000 et alliance Rainforest) lui permettant une valorisation sur le marché international (Kenya).
 La récolte du thé à la main. © Photo DR
La récolte du thé à la main. © Photo DR
* Le riz
La visite des rizières a également marqué les esprits. Les agricultrices ont rencontré une coopérative regroupant plus de 1.200 membres travaillant des parcelles aménagées et mises à disposition par l’État (marais de plus de 127 hectares). Comme pour le thé, la culture du riz au Rwanda repose entièrement sur un travail manuel. Elles ont pu observer le dur labeur des riziculteurs, qui repiquent, entretiennent et récoltent les plants à la main, sans mécanisation. Cette approche traditionnelle met en évidence l’importance du travail humain dans l’agriculture rwandaise, et la nécessité d’une organisation rigoureuse pour assurer des rendements optimaux.
 La récolte du riz. © Photo DR
La récolte du riz. © Photo DR
* La pêche sur le lac Kivu
Autre moment fort du voyage, la découverte de la pêche de nuit sur le lac Kivu. Les pêcheurs, organisés sous forme de coopératives, pèchent de nuit les “isambaza“ (des petits poissons) par attraction lumineuse pendant vingt-quatre nuits par mois. La transformation et la commercialisation des poissons sont assurées par les femmes rwandaises. Cette expérience a permis de mettre en lumière le rôle complémentaire de la pêche dans l’alimentation des populations locales et son importance économique, les pêcheurs étant les seuls reconnus officiellement, le statut d’agriculteur n’existant pas au Rwanda.
 Pêche sur le lac Kivu. © Photo DR
Pêche sur le lac Kivu. © Photo DR
* École agricole et vétérinaire de Kabutare
Les agricultrices ont visité une école agricole qui regroupe 700 élèves dont 500 filles. L’école dispose d’une ferme (vaches laitières, cochons, chèvres, moutons...), et possède 64 hectares. L’établissement assure aux élèves une formation qualifiante dans les productions rwandaises, et leur permet de se tourner vers la profession de vétérinaire.
* Le miel
Les agricultrices françaises ont été accueillies par des femmes victimes de violences conjugales, qui, pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants, ont créé une coopérative d’apicultrices, et développé la filière du miel (miel, cire, produits cosmétiques, hydromel).
* Les ananas, bananes, pommes de terre…
Lors de leur séjour, les agricultrices ont également été amenées à rencontrer de nombreux producteurs de fruits et légumes. Cette agriculture vivrière est essentiellement destinée à la consommation de la famille ou est vendue sur les marchés locaux.
* Le soja
La dernière étape du voyage a consisté à la découverte de la production de soja, et à sa transformation en lait, farine, tofu et thé par des agricultrices réunies en coopérative (COCOF - COmité COnsultatif des Femmes) qui, à l’origine regroupait des veuves et des dames seules à la suite du génocide. Concernant l’élevage, les agricultrices ont constaté qu’il s’agit principalement d’animaux (chèvres, moutons, volailles, vaches…) contribuant à l’alimentation des familles et leur générant un revenu.
Un volet touristique et historique
Ce voyage d’étude ne s’est pas limité à l’agriculture. Apportant une touche de détente et de tourisme à ce séjour intense, les participantes ont également découvert le patrimoine historique et culturel du Rwanda. Elles ont ainsi visité le musée de l’Environnement qui met en exergue la modernité du pays, lequel considère que l’environnement est un sujet majeur (développement des énergies renouvelables, interdiction des emballages plastiques, …). Elles se sont également rendues au Palais du roi Mutara III où elles ont pu caresser les vaches sacrées, dénommées Inyambo. Lors de la traversée jusqu’à l’île Napoléon sur le lac Kivu, elles ont été fortement étonnées de voir les vaches nager d’île en île pour pâturer les herbages.
 Les vaches sacrées au palais royal. © Photo DR
Les vaches sacrées au palais royal. © Photo DR
 Vaches nageant d’île en île. © Photo DR
Vaches nageant d’île en île. © Photo DR
Un échange humain culturel et enrichissant
Au-delà des visites techniques, ce voyage a été l’occasion d’échanges constructifs avec des agriculteurs et agricultrices rwandais. Les discussions ont porté sur les défis communs liés à l’agriculture, ainsi que le rôle essentiel des femmes dans le développement agricole. Elles ont également découvert que ces agricultrices sont organisées sous forme de coopératives, notamment pour la production de pommes de terre et de légumes nourriciers, favorisant ainsi une meilleure structuration de leur activité, et un accès facilité aux marchés. Les agricultrices françaises ont été profondément impressionnées par le courage et la détermination des travailleurs rwandais et rwandaises. Elles ont admiré leur force et leur résilience qui, malgré un manque de mécanisation et des conditions parfois difficiles, parviennent à tirer le meilleur parti de leurs terres. Cet engagement quotidien dans un travail manuel exigeant illustre la volonté de faire prospérer l’agriculture rwandaise et d’assurer une production alimentaire durable pour les générations futures.
Contraste entre modernité et précarité
Lors de leur séjour, les agricultrices françaises ont été frappées par le contraste saisissant entre la modernité du pays et la précarité de certaines conditions de vie. D’un côté, le Rwanda impressionne par son organisation rigoureuse : les routes principales sont bien entretenues et goudronnées, la circulation est strictement régulée avec des radars omniprésents, la divagation des animaux est interdite, les drones servent au transport des paillettes de semences pour les inséminations artificielles. Les habitants sont tenus de porter des chaussures, témoignant d’une politique de santé publique et d’hygiène rigoureuse. Ils sont, pour la plupart, détenteurs de téléphone portable. Cependant, malgré ces avancées, la population rurale vit encore dans des conditions modestes, marquées par un accès limité aux infrastructures modernes, et une forte dépendance à l’agriculture manuelle. Ce contraste met en lumière les défis que le pays doit encore relever pour assurer un développement équitable et durable à l’ensemble de sa population.
Un voyage inspirant pour l’avenir
De retour en France, les agricultrices du Grand Est repartent avec de nouvelles idées, et une ouverture renforcée sur d’autres pratiques agricoles. Ce type d’initiative illustre l’importance et la richesse du partage des savoirs et des expériences entre agriculteurs et agricultrices à travers le monde. Il renforce également les liens entre les femmes engagées dans l’agriculture, quelles que soient leurs origines, prouvant que la solidarité et l’innovation sont des clés essentielles pour l’avenir de l’agriculture mondiale. Face au succès de ce voyage, les agricultrices du Grand Est s’interrogent sur l’idée de renouveler ces échanges internationaux, et donner envie à d’autres agricultrices de partager ces moments si enrichissants.
AFDI, Un acteur clé du développement agricole internationalL’Afdi (Agriculteurs Français et Développement International) est une association créée en 1975 par les Opa (Apca, Cnmcca, Fnsea et Ja) pour soutenir le développement agricole dans plusieurs pays à travers le monde. Son objectif est d’accompagner les agriculteurs et leurs organisations en favorisant le partage de compétences et la mise en place de coopérations durables. Ses principales missions sont : - Le renforcement des organisations paysannes (Op) pour améliorer leurs capacités de gestion et de production. - L’appui à la formation des agriculteurs pour leur permettre d’adopter des techniques adaptées à leur environnement. - L’échange d’expériences entre agriculteurs français et étrangers pour favoriser l’innovation et l’entraide. - Le plaidoyer pour défendre une agriculture familiale et durable à l’échelle internationale. L’Afdi Lorraine (créée en 1994) rattachée désormais à Afdi Grand-Est, compte une centaine de membres et collabore avec des Organisations Paysannes au Togo (Rejeppat-rc) et au Rwanda (Imbaraga). |
IMBARAGA, Une organisation paysanne au RwandaImbaraga œuvre au Rwanda pour la promotion et la défense des droits des agriculteurs. Créée en 1992, l'association regroupe aujourd’hui plusieurs milliers de membres issus de différentes régions du pays. Son objectif principal est d’améliorer les conditions de vie des petits producteurs agricoles à travers le renforcement de leurs capacités, la promotion de bonnes pratiques agricoles, et la défense de leurs intérêts auprès des institutions publiques et privées. L’association Imbaraga poursuit plusieurs missions : - Renforcement des capacités des agriculteurs par de la formation, et un accompagnement en gestion et commercialisation des produits agricoles - Plaidoyer et défense des droits des agriculteurs - Promotion du développement rural et de l’agroécologie (agriculture durable et pratiques respectueuses de l’environnement) - Amélioration des revenus des agriculteurs (facilitation de l’accès aux marchés et aux circuits de commercialisation, accès au crédit) Grâce à ses actions, Imbaraga joue un rôle clé dans le développement du secteur agricole au Rwanda, contribuant ainsi à l’amélioration des conditions de vie des agriculteurs et à la sécurité alimentaire du pays. |