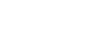Une récente étude du Bureau T, la filiale conseil de la Caisse des Dépôts, dresse un tableau inquiétant de l’agriculture française à l’horizon 2050. Frappé par le réchauffement climatique et le vieillissement des paysans, le pays se couvre de friches agricoles.
L’année 2050 n’est pas plus éloignée de nous que l’an 2000, si l’on calcule bien. Donc, elle arrive vite. A quoi ressemblera l’agriculture française à ce moment-là ? C’est la question que se posent les chercheurs du Service conseil expertise des territoires (Scet), cabinet d’études de la Caisse des dépôts. Pour cet exercice de prévision, intitulé « Prospective 2050, entre crises et transformations, quel avenir pour l’agriculture française ? », les chercheurs ont pris en compte soixante paramètres par département : le changement climatique, l’évolution des coûts de production, la perte de compétitivité à l’international, la démographie, le vieillissement de la population agricole et la demande de main d’œuvre. Les prévisions sont pessimistes : « 35 à 40 % du produit intérieur brut agricole pourraient être menacés avec des répercussions sur toutes les filières. Ce qui concerne 40 % de la surface agricole », déclare Romain Lucazeau, directeur général de la Scet. « Toute la France agricole est touchée, pas seulement le sud, ce qui entraîne une perte de 15 milliards d’euros (…) 54 départements seraient exposés à une profonde transformation de leur agriculture. »
Le temps des friches agricoles
Ces résultats s’expliquent pour moitié par le réchauffement climatique. Les cultures végétales (les seules d’ailleurs analysées par l’étude qui a laissé de côté les productions animales) étant largement pénalisées notamment l’arboriculture, le maïs et le maraîchage. La spécialisation des régions accentue ces mécanismes. En Alsace par exemple, la moitié des légumes cultivés sont du chou. Or ce légume est très fragile ce qui entraîne une crise lorsque la production s’effondre. Phénomène similaire en Provence où l’on produit 20 % de la tomate française, mais le manque d’eau augmente les prix et favorise la concurrence internationale. Le département du Var est dépendant à 80 % de la viticulture, la Bretagne repose sur le chou-fleur. Mêmes crises économiques donc quand les rendements baissent par suite des sécheresses à répétition. Si certaines productions peuvent « remonter » vers le nord pour s’adapter, la logistique ne suit pas, ni les entrepôts ni les usines de transformation.
Confrontés à des pertes de revenus sur ces terres asséchées, les agriculteurs ne trouvent plus à vendre leurs exploitations à l’âge de la retraite, si ce n’est à des fonds publics qui gèrent des espaces abandonnés à la nature. La déprise agricole s’accentue. « On connaissait les friches industrielles, voici le temps des friches agricoles, difficiles à valoriser en pleine campagne abandonnée », ajoute Romain Lucazeau, « pourtant elles émergent déjà, sous forme de mitage, faut-il les laisser à la Nature », s’interroge celui qui est aussi auteur de romans de science-fiction.
Planification écologique
Face à ce scénario catastrophe deux solutions sont envisagées par les auteurs de l’étude : Tout d’abord, le modèle du laisser-faire et du libre cours aux forces du marché. Ce qui entraîne un essor des exploitations « firmes » pour produire une alimentation de masse à bon marché. Mais les auteurs savent bien que ce n’est pas la tradition française. La France a une tradition de planification agricole et d’aménagement du territoire. « L’Etat intervient (seconde solution, ndlr) et en contrepartie les agriculteurs font des efforts en faveur de l’écologie. Des actions qu’il faut envisager dès maintenant », explique Paloma Pardineille, directrice de la stratégie de Bureau T. Cette seconde solution, celle de la « planification écologique » permet de protéger l’environnement et les paysages dans un souci d’intérêt général. La souveraineté alimentaire est garantie en volume et en qualité sur l’ensemble du territoire.
L’Etat renforce sa maîtrise du foncier agricole en préemptant terrains et bâtis et les met à disposition des agriculteurs. En forçant le trait, cette étude sous forme de conte de science-fiction, a le mérite de nous alerter sur les menaces qui pèsent sur notre terre nourricière.
L’étude complète sur le lien suivant : www.scet.fr/lagriculture-en-2050-crise-ou-transformation