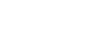« Principe de précaution ou principe d’innovation : Quel avenir pour l’agriculture française ? ». Tel était le thème du débat qu’ont organisé l’Association générale des producteurs de blé et Unigrains fin février sur le Salon de l’Agriculture. Quand le poids de normes juridiques entrave le développement de la production…
Précaution et innovation sont-ils deux principes irréconciliables ? Non si l’on considère que « la réglementation doit s’adapter au temps des cultures et à celui de l’innovation et non pas l’inverse », a répondu la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, venue ouvrir les débats sur cette « question sensible », de son propre aveu. « Laissons les agriculteurs entreprendre pour les intérêts supérieurs de la Nation et de son économie », a-t-il ajouté. Au-delà de ces déclarations d’intention, la réalité s’est révélée plus cruelle. Car bien que la volonté première du Président Chirac n’a jamais été d’entraver la recherche et l’innovation, ce sont les normes juridiques qui ont découlé de ce principe, intégré dans la Constitution en 2005, qui ont entravé l’agriculture, ont reconnu l’ensemble des intervenants.
Procédures lourdes
« Au point que le principe de précaution est devenu un principe d’inaction », a tranché le président de l’AGPB, Eric Thirouin, inquiet de mesurer les conséquences des normes qu’il a générées sur l’agriculture française. Pour preuve, « le code de l’environnement est passé de 1 000 pages au début des années 2000 à environ 7 000 pages aujourd’hui », a souligné l’avocat Timothée Dufour pointant les nombreuses surtranspositions et distorsions de concurrence qui freinent l’économie agricole. Certaines administrations publiques et associations militantes sont devenues les gardiennes implacables de ce dogme (lire encadré). Laurent Guerreiro, président du Directoire du groupe RAGT, mesure au quotidien l’impact du principe de précaution sur son activité. « L’innovation, c’est notre fonds de commerce. Chaque année, nous consacrons 15 % de notre chiffre d’affaires à la recherche », a-t-il souligné. Ce qui représente, bon an mal environ 80 millions d’euros par an. Ses 400 chercheurs aimeraient pouvoir faire plus et mieux, mais « les règles françaises et européennes nous empêchent de travailler par exemple sur les NGT ou sur les fourrages endophytes »,-a-t-dit. Ces derniers ont l’avantage de résister à la sécheresse. « Mais les procédures sont lourdes. Il faut passer par l’Agence de sécurité sanitaire (Anses) qui demande de déposer un dossier. Coût : 40 millions d’euros l’étude, sans avoir la garantie de pouvoir commercialiser les semences au bout du processus », a-t-il soufflé.
Retour sur investissement
Pour Eric Thirouin, « nous avons besoin de normes. Elles sont aussi là pour nous protéger. Mais on a l’impression que la machine s’est emballée », citant l’exemple que c’est maintenant la « norme qui définit la date à laquelle semer, et non plus la météo ou l’état des champs. Pour l’Europe et l’administration française, le printemps commence le 1er janvier. Si je veux semer mes orges fin décembre, parce que les conditions le permette, je serai sanctionné », a-t-il illustré. Le principe de précaution semble d’autant moins compatible avec l’innovation qu’on « travaille sur le temps long. Il nous faut donc un cadre clair pour qu’on puisse asseoir et consolider notre risque financier », a remarqué Laurent Guerreiro. Mettre au point une nouvelle semence prend entre six et quinze ans et réclame de lourds investissements. Comme tous ses concurrents, le président de RAGT veut être assuré d’un retour sur investissement. D’autres verrous doivent sauter, notamment celui de l’acceptation sociale de l’innovation. C’est ce qui se passe avec les OGM et les NBT, dont « aucun document scientifique n’a montré qu’il était nocif pour la santé humaine, animale ou pour l’environnement », a martelé Laurent Guerreiro. « Mais on n’arrive pas à convaincre quelqu’un qui ne veut pas être convaincu », s’est-il désolé.
|
L’activisme associatif nuisible à l’innovation Timothée Dufour a vilipendé les associations environnementalistes et antispécistes du type Soulèvements de la Terre, Extinction Rebellion, L214, etc. qui constituent « un frein à la compétitivité de l’agriculture ». Surfant sur les règles de droit issues du principe de précaution, « elles se permettent tout, souvent avec des actes violents ». RAGT a vu, dans la seule année 2024, pas moins de 30 de ses parcelles détruites par des activités écologistes. « Des destructions souvent aveugles », a témoigné Laurent Guerreiro. « Ces actions ne doivent pas rester impunies. La justice doit être la même pour tous », a exigé Eric Thirouin qui demande l’appui des politiques et « un test systématique de représentativité » pour ces associations qui ne représentent finalement qu’une très faible minorité de la population. |