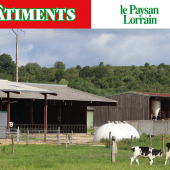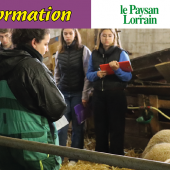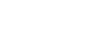La naissance de l’Association générale des producteurs de blé (AGPB) en 1924 répondait au noble objectif de se structurer, pour défendre les intérêts d’une seule et même production. Elle a débouché sur des luttes héroïques pour consolider «un revenu digne». Les créations de l’Office des Blés, en 1936, puis de l’Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) en 1940 constituent l’aboutissement du travail de fond mené par le syndicalisme céréalier. L’innovation dans les techniques culturales et dans la mécanisation agricole marquera l’aprèsguerre. L’Agpb contribuera largement à la vulgarisation du "progrès" auprès du plus grand nombre, pendant plus de trois décennies. Tout en adaptant le paysage céréalier aux évolutions de la Pac et à la mondialisation des échanges. La dernière décennie a été marquée par une préoccupation grandissante du nécessaire respect de l’environnement, du changement climatique et de la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau.
Les céréaliers lorrains ont souhaité célébrer ce centenaire, en organisant un colloque, le mardi 29 avril, à Hauconcourt. Une journée qui s’attachera à tracer les pistes d’avenir pour des systèmes de production et une filière très structurée sur le territoire régional : des coopératives ancrées dans leur terroir et l’accès au commerce européen par la Moselle canalisée.
La presse agricole de Lorraine s’associe à l’évènement, en publiant un dossier spécial qui s’ouvre sur une diversité de témoignages. Ces exploitants que nous avons rencontrés et ces coopératives mettent en oeuvre, au quotidien, des stratégies de résilience et d’innovation, souvent basées sur les nouvelles technologies.
L’enjeu sera de franchir le cap des nouveaux défis imposés par le contexte de 2025, bien loin de celui de 1924, mais qui sous-tend, lui-aussi, beaucoup de détermination.
Introduction par Jean-Luc MASSON, Le Paysan Lorrain
Au sommaire :
 |
Centenaire L'histoire de l'AGPBDepuis sa création il y a près d’un siècle, l’Association générale des producteurs de blé et autres céréales (AGPB) s’engage pour tous les céréaliers de France. |
 |
Terre d'Horizon (88) Une coopérative polyvalente, engagée au plus près des réalités du terrainÀ 35 ans, Olivier Guyon est l’un des associés du GAEC Les Noisetiers, une exploitation de polyculture-élevage implantée à Saint-Étienne-lès-Remiremont, en zone de montagne. Membre de la coopérative Terre d’Horizon depuis plusieurs années, il en est aussi le vice-président et administrateur depuis 2014. |
 |
GAEC des deux cours (88) "Une autre approche de l'agriculture"Exploitation en polyculture-élevage dans les Vosges, le Gaec des deux cours a adhéré à la démarche be Api proposée par la Coopérative Agricole Lorraine. Après deux années pour analyser l’ensemble de leur parcellaire, hors surfaces en herbe, les exploitants pratiquent la modulation des engrais de fond et de l’azote depuis deux campagnes. |
 |
Recensement général agricole 2020 Grand Est Des exploitations moins nombreuses et plus grandesLe Grand Est compte près de 41.000 exploitations agricoles pour plus de trois millions d’hectares de surface agricole utile en 2020. La baisse des effectifs se poursuit, mais la région semble relativement épargnée par rapport au reste de la métropole et le rythme de disparition des exploitations se stabilise sur les deux dernières décennies. |
 |
Coopération (57) De la farine mosellane avec des blés mosellansAu silo comme au chai, c’est dans l’assemblage des grains que se travaille la renommée des moissons du Groupement des producteurs de blé Dieuze-Morhange (GPB). Pour diversifier ses marchés sur le territoire, la coopérative du centre mosellan a investi dans la meunerie. |
 |
Gérard Léonard, Anderny (54) Les changements climatiques obligent à la résilienceGérard Léonard est un pionnier de l’agriculture de conservation des sols. Selon lui, la maîtrise des coûts joue en faveur de l’environnement. Il pense que l'agriculture passe évidemment par l’évolution technologique mais à condition de conserver du revenu sur les fermes. Investi syndicalement, il a coordonné l'événement lié au centenaire de l'AGPB. |
 |
GAEC de Longpré, à Quincy-Landzécourt (55) Se former pour mieux appréhender le solÀ Quincy-Lanzécourt, le GAEC du Longpré illustre une dynamique de transition agricole où observation, formation et innovation s’entremêlent. Porté par Arnaud Lemarchal et ses associés, ce système en polyculture-élevage mise désormais sur une meilleure connaissance des sols et une approche globale de l’exploitation pour concilier performance économique, autonomie et durabilité. |
 |
Benjamin Gobert, Saint-Supplet (54) Un agriculteur entrepreneur dans son siècleBenjamin Gobert, agriculteur en Meurthe-et-Moselle âgé de 30 ans, bénéficie déjà d’un parcours très dense et dynamique dans son métier. Il diversifie son activité par le travail à façon et la valorisation dans les nouvelles énergies. Il est également engagé dans les organisations professionnelles. |
 |
Julien Gentry, à Laneuvelotte (54) Engagé pour une agriculture résilienteJulien Genay est installé en polyculture-élevage à Laneuvelotte (54) et il a opté pour une agriculture de conservation des sols. Il est engagé au sein de la Coopérative Agricole Lorraine, dont il préside la commission Terrevolution, qui oeuvre à favoriser les synergies entre les différentes branches métiers de la CAL dans le but de repenser l’agriculture de demain. |
 |
Polyculture-élevage (57) Céréalier et éleveurAdepte du système de polyculture-élevage, Pierre Herfeld s’efforce d’être un communiquant. Installé dans un des territoires les plus urbanisés de la Moselle, il compose dans un environnement contraint. |
Les articles du dossier ont été publiés dans les pages du journal du 25 avril 2025.
|
Prochain dossier à paraître : Le vendredi 2 mai le journal a été livré avec un nouveau dossier : spécial Energie. Vous retrouverez prochainement les articles sur notre site web. |